
Caroline Farmer est experte codificatrice et responsable du maintien de l’uniformité des pratiques de codage entre les Centres hospitaliers du Haut-Valais et du Valais romand. Ancienne codificatrice de terrain, Mme Farmer connaît toute l’histoire du codage, et maîtrise le système DRG. Son expertise en fait un témoin privilégié d’un contexte qui n’a cessé de se complexifier depuis 2012.
Quel est aujourd’hui votre rôle au sein de l’Hôpital du Valais ?
Je veille à la continuité et à l’uniformité des pratiques entre les deux centres hospitaliers. Mon rôle est transversal : je développe des contrôles pour garantir la qualité du codage, en lien avec les équipes sur le terrain. J’ai eu la chance de travailler avec des data analystes qui m’ont formée à des outils comme Power BI ou le langage DAX. Aujourd’hui, je peux exploiter les données de manière beaucoup plus fine. Comme je suis le codage depuis ses débuts, je connais bien les règles, les classifications et les logiques des différentes structures tarifaires, ce qui me permet de faire des liens entre les aspects médicaux, financiers et organisationnels que peu de personnes peuvent croiser.
Quels sont les changements majeurs que vous avez observés dans le codage depuis vos débuts ?
Au début, à l’hôpital de Sion, il y avait deux codificatrices sans formation médicale spécifique. Les règles étaient plus simples, on pouvait se permettre de recruter des personnes sans formation médicale approfondie. Aujourd’hui, ça n’est plus envisageable.
Les derniers postes que j’ai ouverts étaient destinés à des médecins ou à des infirmières spécialisées. On n’a plus le temps de former sur le plan médical. Il faut être capable de lire un dossier et de l’interpréter correctement. Parce que l’important est dans le détail : comprendre un résultat de labo, évaluer un degré de sévérité, faire les bons liens. Et tout ça a une influence directe sur la facture.
La documentation médicale aussi a dû s’adapter à ces changements ?
Oui, au début, certains médecins refusaient de donner leurs lettres de sortie et de documenter leurs gestes. Aujourd’hui ça n’est plus possible. La documentation est essentielle. On ne peut plus parler d’un diagnostic sans précision. Ce qui a fait évoluer la collaboration avec le corps médical et médico-thérapeutique. La relève a grandi avec cette culture. C’est plus simple aujourd’hui.
Et du côté du système en lui-même – réglementations, structures tarifaires, codage – comment les exigences ont-elles évolué ?
Les codes dits « complexes » ont tout changé. Ils exigent un nombre précis de minutes de traitement, des critères stricts, un suivi détaillé. On ne peut plus juste mettre un code: il faut tout anticiper, structurer, prouver.
Avec les contestations des caisses-maladie, la documentation doit être complète et structurée. Dans certains domaines, comme la réadaptation, on est passés d’un forfait à un plan de traitement minuté. La charge administrative est énorme. Ce n’est plus le travail d’une codificatrice seule, ça demande une vraie organisation en amont.
«Aujourd’hui les codificatrices arrivent avec de solides bases médicales, mais ce n’est plus suffisant. Il faut aussi maîtriser les règles de codage, suivre les évolutions du système DRG, comprendre les enjeux financiers… et être à l’aise avec des outils comme Excel ou Power BI.»
Caroline Farmer, experte codificatrice à l’Hôpital du Valais.
Les hôpitaux ont dû s’organiser pour absorber tout ce travail administratif en plus. Comment ça s’est mis en place ?
En 2003, on est passé d’une facturation au forfait à une facturation par APDRG et on a dû renforcer les équipes. Puis en 2010, en prévision des SwissDRG on avait aussi augmenté les équipes, car il y avait des exigences supplémentaires et on devait répertorier plus de caractéristiques.
Le codage est-il totalement réalisé en interne ?
En général, oui, nous ne sous-traitons pas. Depuis 2001, on est centralisés. On a un bassin de codificatrices suffisant pour tout gérer à l’interne.
Quels sont aujourd’hui les principaux défis auxquels le codage est confronté ?
Le recrutement, la relève et la formation sont toujours les gros sujets. Il y a beaucoup de mouvement dans le codage. Quand une codificatrice part, il faut pouvoir assurer la transition. Et nous n’avons plus le temps de les former.
Et puis le respect des délais. Entre la sortie du patient et la finalisation du dossier, il y a souvent trop de temps. Parfois le dossier semble prêt, mais après analyse, on découvre qu’il manque encore des documents.
Concrètement, comment votre travail de contrôle soutient-il les centres sur le terrain ?
Je développe des contrôles, soit de manière spontanée, soit à la demande des centres. Je fais aussi des rapports d’analyse, des révisions de codage. Je travaille beaucoup sur les années passées : je reprends les données, je croise des labos, des prestations, des médicaments, je crée des listes de cas à vérifier.
Ce sont les centres qui décident s’ils ouvrent ou non les dossiers que je leur signale. On a un fichier partagé qui permet de suivre les plus-values ou non, et de documenter pourquoi tel contrôle a été pertinent ou pas. En 2024, les contrôles ont permis de corriger de nombreux codage en faveur de l’hôpital. Donc ce travail a son importance.
La codification est devenue une expertise ultra complexe !
Oui, aujourd’hui les codificatrices arrivent avec de solides bases médicales, mais ce n’est plus suffisant. Il faut aussi maîtriser les règles de codage, suivre les évolutions du système DRG, comprendre les enjeux financiers… et être à l’aise avec des outils comme Excel ou Power BI. Ce sont des compétences très variées, difficiles à réunir. Sans compter l’aspect relationnel, car sans échanges fluides avec toutes les équipes et même dans les services, le codage est souvent incomplet. C’est un métier à la croisée de plusieurs mondes.
Dans ce contexte, quel rôle les outils informatiques sont-ils amenés à jouer?
A l’époque on avait un ordinateur pour trois codificatrices. Aujourd’hui on ne peut plus s’en passer. La planification hospitalière, par exemple, nous impose ses contraintes avec les postulations et le nombre de cas à respecter pour maintenir certaines activités, etc. Les logiciels nous aident beaucoup avec ça.
Est-ce que les outils dont vous disposez actuellement répondent à vos besoins ?
On a de bons outils, comme Business Object, Power BI, mais ils ont leurs limites. Notamment à cause des règles de codage qui évoluent tout le temps. Et surtout, ils manquent d’interopérabilité. On n’arrive pas à tout mettre en lien. Pour obtenir des résultats, je dois encore faire énormément de manipulations. Je rêve d’un outil qui permettrait de tout croiser, mais ce n’est pas le rôle d’un hôpital de développer ça. Et puis les contraintes budgétaires nous forcent à trouver des solutions innovantes.
Que pensez-vous de l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le domaine du codage ?
Je suis ambivalente sur le sujet. Par moments, je suis très enthousiaste, je me dis que c’est une voie d’avenir, que ça peut simplifier, automatiser et rendre l’analyse plus exhaustive. La protection des données étant un sujet hautement important à prendre en compte, tout comme la question de l’alimentation en données de la machine, qui pourrait entraîner des biais. Il faut avancer par étapes. Je pense que les besoins des codificatrices des centres hospitaliers publics ne sont pas les mêmes que ceux d’une clinique spécialisée qui fait des prothèses en planifié. Mais j’espère que dans un avenir proche, l’IA va nous aider à dégrossir le travail d’analyse qui se fait en amont du codage. J’aime bien suivre l’évolution des différentes applications.
Canadienne d’origine, Caroline Farmer débute sa carrière au CHUV en 1999, avant de rejoindre le Valais où elle participe à la mise en place du codage médical, d’abord pour l’hôpital de Sion, puis pour l’ensemble du canton. En 2017, le canton décentralise l’activité de codage, elle quitte alors le codage opérationnel pour un rôle plus transversal de contrôle du codage pour les deux Centres hospitaliers romand et Haut-Valais.
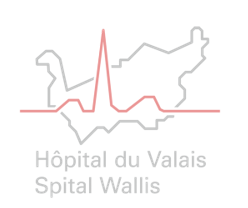
Articles associés

Meet the team Regina
Nous sommes ravis d’accueillir Regina Hoffmeister, qui a récemment rejoint l’équipe de codage de Swisscoding pour renforcer notre présence en Suisse alémanique.

Meet the team Marie
Marie Gargallo a rejoint Swisscoding Technologies en septembre, pour contribuer au développement commercial de notre CODY, notre solution de codage par l’intelligence artificielle.

