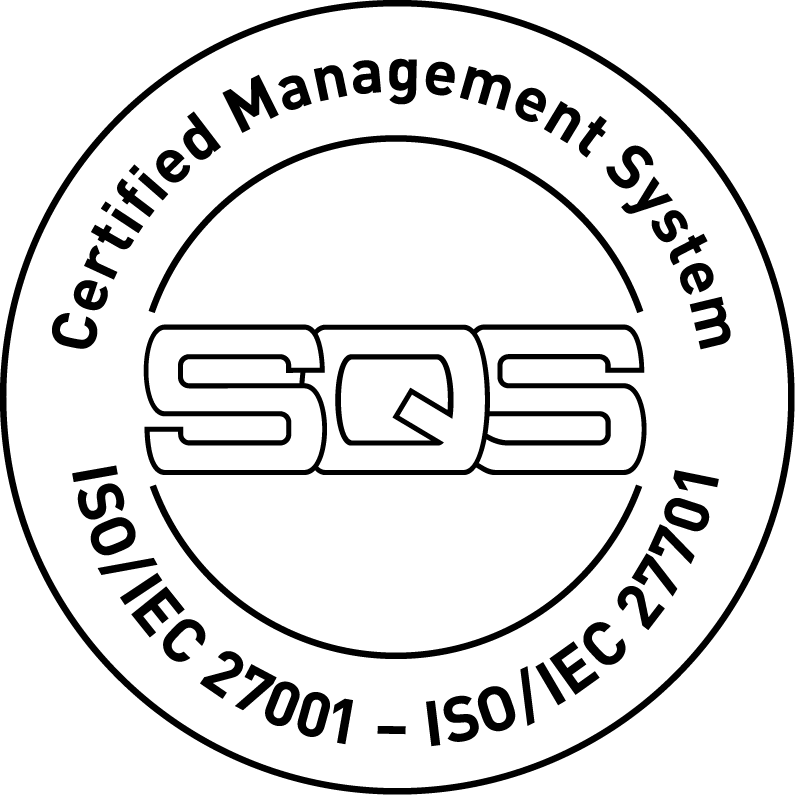Alfred Bollinger a consacré près de 25 ans à structurer et faire évoluer le codage médical en Suisse. Ancien chef du service de codification de l’Hôpital universitaire de Zürich, il a toujours défendu une approche exigeante mais profondément humaine du codage. Aujourd’hui expert chez Swisscoding, il partage son regard sur les enjeux du secteur, les limites du système actuel et le potentiel de l’intelligence artificielle.
Quel rôle joue le codage médical dans le fonctionnement global d’un hôpital aujourd’hui?
Le codage médical est un rouage stratégique du fonctionnement hospitalier. Il fait le lien entre les professionnels de santé et la direction des finances, en garantissant que les prestations fournies soient correctement traduites en données facturables. Pour que ce codage soit précis et conforme, il doit s’appuyer sur une documentation médicale exhaustive, de qualité, produite dans des délais courts. C’est un travail exigeant, qui repose autant sur l’expertise technique que sur des relations humaines de confiance.
Comment l’avez-vous vu évoluer depuis vos débuts, tant sur le plan technique qu’organisationnel?
Quand j’ai commencé à coder, nous travaillions avec environ 36 000 codes pour les traitements (CHOP) et un ensemble de données de codage comprenant au maximum dix champs de diagnostics et de procédures. Ce qui était à peine suffisant pour les prestations complexes des hôpitaux universitaires. Aujourd’hui, nous disposons de plus de 23’000 codes de procédure, d’un ensemble de données avec un nombre illimité de champs pour les codes de diagnostic et de procédure, et la documentation médicale est devenue beaucoup plus complète. Cette évolution exige une expertise médicale pointue, aussi bien de la part des codificatrices que des soignants, d’autant que le système évolue chaque année avec les modifications des DRG. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que de jeunes professionnelles doivent aujourd’hui assimiler une quantité de connaissances qui, à mes débuts, n’existait tout simplement pas.
Quelles sont aujourd’hui les principales exigences imposées aux hôpitaux en matière de codage médical?
Aujourd’hui, la facturation est directement liée au codage, ce qui place les hôpitaux dans une logique de performance. Ils doivent être réactifs face aux évolutions du système, intégrer les innovations médicales, et adapter leur fonctionnement aux changements annuels des DRG, qui peuvent transformer une prestation rentable en perte financière. Le codage exige une documentation médicale précise, complète et disponible à temps, ce qui suppose une organisation rigoureuse. Mais dans un contexte de déficit généralisé, les hôpitaux peinent à investir dans les ressources nécessaires. Réduire le personnel du codage pour économiser à court terme, c’est prendre le risque de pertes financières importantes en fin d’année.
«Cette évolution exige une expertise médicale pointue, aussi bien de la part des codificatrices que des soignants, d’autant que le système évolue chaque année avec les modifications des DRG. Ce qui m’impressionne le plus, c’est que de jeunes professionnelles doivent aujourd’hui assimiler une quantité de connaissances qui, à mes débuts, n’existait tout simplement pas.»
Alfred Bollinger, spécialiste médical en codification chez Swisscoding
On comprend que le codage exige des compétences spécifiques, mais qu’en est-il de la formation? Existe-t-il une filière pour former les codificatrices médicales?
Il n’existe pas aujourd’hui en Suisse de véritable filière structurée pour former les codificatrices médicales. Il y a bien un brevet fédéral, avec un examen officiel, mais pas de formation pratique en amont. Les cours proposés, notamment par H+ et Swisscoding, restent souvent théoriques et, en raison de leur durée, ne peuvent traiter qu’un choix et un nombre limités d’exemples pratiques de codage. Le problème, c’est que seuls les grands hôpitaux ont les ressources nécessaires pour former des codificatrices en interne, sur deux ou trois ans. Les petits établissements, eux, n’ont ni le temps ni le budget pour accueillir des personnes en formation. Résultat : ils ne peuvent engager que des professionnelles déjà formées, ce qui limite fortement le renouvellement des effectifs. Les assureurs et les entreprises privées actives dans le domaine du codage ou de la révision du codage misent également sur des spécialistes du codage déjà formées et expérimentées, ce qui augmente encore la pression sur les hôpitaux qui assurent la formation.
Donc avec plus d’effectifs, la charge du codage sur les institutions hospitalières serait allégée?
Oui, mais il ne s’agit pas seulement de ressources humaines. Il faudrait aussi investir dans des outils numériques plus évolués. On parle depuis des années du dossier médical électronique, de documentation structurée, d’échange de données entre institutions…, mais rien n’avance vraiment. Aujourd’hui, une grande partie de la documentation médicale n’est pas utilisable automatiquement : elle est rédigée dans Word, elle n’est pas standardisée, donc peu exploitable par une machine. Si l’on veut améliorer la qualité du codage, il faut repenser le système d’information hospitalier, pas seulement ajouter du personnel, mais aussi investir dans des solutions intelligentes qui allègent le travail humain et augmentent la qualité.
Dans ce sens, l’IA est une bonne voie, selon vous?
Oui, l’intelligence artificielle est une piste prometteuse. Elle apprend à coder à partir des cas réels issus de bases de données massives, et réussit à proposer des codes en lien avec la documentation disponible. Elle peut déjà coder automatiquement des cas simples, comme en orthopédie ou en obstétrique, ce qui libérera du temps aux codificatrices pour les cas complexes ou pour accompagner les équipes médicales et participer au développement des outils eux-mêmes.
Donc l’IA pourrait transformer le métier du codage, à terme?
Grâce à ces nouveaux outils, les jeunes codificatrices qui arrivent aujourd’hui ne feront plus du tout le même métier que moi. Tout le système va changer. C’est pourquoi il faut les préparer à cela. Même à la retraite, je continue à m’impliquer parce cette transformation me tient à cœur. Je travaille déjà avec les développeurs de Swisscoding pour intégrer les règles de codage dans l’outil, expliquer les cas, faire en sorte que la machine apprenne correctement.
Quelle est votre souhait pour l’avenir du codage médical et du système SwissDRG?
Je souhaite que le codage médical soit un métier reconnu pour sa valeur stratégique et que les hôpitaux allouent les ressources financières et humaines nécessaires à cette fin. Ce que j’espère, c’est qu’on retrouve plus de confiance entre les institutions : entre les hôpitaux, les codificatrices, les médecins et les assureurs. On est entré dans une logique de méfiance, presque de confrontation, alors que tout le monde vise la qualité des soins et la justesse des prestations. Si l’intelligence artificielle peut contribuer à rétablir cette confiance – par sa neutralité et sa transparence – alors c’est une bonne chose.
Articles associés

Meet the team Regina
Nous sommes ravis d’accueillir Regina Hoffmeister, qui a récemment rejoint l’équipe de codage de Swisscoding pour renforcer notre présence en Suisse alémanique.

Meet the team Marie
Marie Gargallo a rejoint Swisscoding Technologies en septembre, pour contribuer au développement commercial de notre CODY, notre solution de codage par l’intelligence artificielle.